Résumé de l’article :
La transidentité risque d’être associée à l’application de la soi-disant « théorie du genre ». Or la transidentité montrerait au contraire qu’il n’est pas possible de manipuler les individus pour leur donner l’envie de changer de genre, pas plus que de les rendre homosexuels.
L’accueil de la transidentité par les autorités françaises est guidée actuellement par une autre « théorie », selon laquelle la transidentité est une grave maladie psychiatrique, ce qui « permet » de rembourser les soins et d’accorder le changement d’état civil en cas de modification irréversible du fonctionnement de l’appareil génital, mais qui a pour contrepartie d’imposer aux personnes un parcours médical et judiciaire long, cher et parfois humiliant, et d’exclure celles qui veulent conserver leur fertilité et ne pas invoquer la maladie.
Il convient de placer désormais L’IVG (Inversion Volontaire de Genre) sous l’angle de la liberté d’être soi, ce qui est arrivé récemment à l’Interruption Volontaire de Grossesse dont la prise en charge ne fait plus référence à la détresse des femmes concernées.
*********
I La transidentité ne prouve pas la « théorie du genre », bien au contraire.
Le magazine Yagg vient d’associer transidentité et « théorie du genre ».
(http://yagg.com/2014/02/06/barneys-new-york-mannequins-trans/. Comme pour l’homosexualité, il convient pourtant d’écarter toute confusion entre les délires des fondamentalistes et la réalité de la transidentité.
La « théorie du genre » serait l’idée selon laquelle un pouvoir politique serait capable de programmer l’hétérosexualité ou l’homosexualité des personnes ou d’instituer des personnes « hommes » et « femmes », indépendamment de leur constitution anatomique.
Depuis le milieu du 20° siècle, on distingue la transidentité de l’homosexualité, la première touchant à l’identité (« qui suis-je »?), la seconde à la préférence sexuelle (« qui j’aime? »), les deux pouvant se combiner.
Le phénomène de la « transidentité » (personne se sentant mieux dans le genre non habituellement associé à son sexe anatomique, que nous appellerons dans la suite de cet article « personne trans ») existe aussi bien dans les anciennes civilisations que dans les sociétés modernes, et d’un bout à l’autre du monde. D’après les chiffres figurant dans le rapport de la Haute Autorité de la Santé en 2009, il y aurait entre une personne sur 10 000 et une sur 40 000 qui aurait recours au système de soins pour cause de transsexualisme dans le monde. Cependant, le nombre de personnes qui vivent une transidentité sans recourir au système de soin est bien supérieur, mais difficilement estimable.
La revendication des personnes trans pour une loi facilitant le changement d’identité légale ne manquera pas d’attirer les foudres des détracteurs de la « théorie du genre », pourtant un pur fantasme confondu avec les études sur le genre. Nous allons revenir ci-dessous sur ces deux notions.
Les études sur le genre, qui ont puisé largement leur inspiration dans la pensée d’auteurs français tel que Michel Foucault ou Simone de Beauvoir, se sont développées d’abord aux États-Unis dans les années 1980. Elles ont mis à jour une évidence que même les plus conservateurs admettent : la nature ne nous fait pas naître femmes ni hommes, elle nous fait naître femelles et mâles, au moins sous l’aspect anatomique (sauf pour certains intersexués). Nul ne conteste non plus que la société intervient ensuite pour assigner aux mâles et aux femelles des rôles et des codes visuels différents, ce qui va créer deux catégories sociales (deux genres), « homme » et « femme ». C’est en ce sens que Simone de Beauvoir a pu écrire « on ne nait pas femme, on le devient ». Il n’est pas non plus contesté que nos sociétés sont de type « patriarcale », dominées par les hommes.
Où les discussions commencent à s’envenimer, concernant les études de genre, c’est sur la description fine des mécanismes de domination à l’œuvre, leur renforcement par la norme hétérosexuelle, et sur les moyens de parvenir à l’égalité et au respect de toutes les sexualités.
En revanche, on est bien en peine de dire à quels penseurs, à quelles autorités scientifiques on pourrait attribuer l’idée selon laquelle un pouvoir politique serait capable de « produire » des personnes transidentitaires ou homosexuelles. C’est pourtant ce que contiendrait la « théorie du genre », d’après ceux qui l’ont inventée pour mieux s’en effrayer…
Mais les personnes trans ne viennent-elles pas confirmer l’application de la « théorie du genre »? En fait, c’est exactement le contraire. La personne qui exprime le besoin de vivre dans le genre qui n’est pas associé à son sexe déclaré à la naissance, quitte parfois à modifier son anatomie, est poussée par un ressenti intime et non par l’application d’une théorie de la part de son entourage : d’ailleurs, sauf très rares exceptions, les parents des personnes trans ont eu le sentiment de tout faire pour que leur enfant respecte son assignation de genre. Si la théorie du genre existait, ce serait la preuve de son échec. Les frères, sœurs, ou enfants des personnes trans ne sont pas trans. C’est l’individu trans lui-même qui, devant l’injonction de la société d’être pleinement homme ou pleinement femme, de ne pas être entre les deux, ne trouve d’autre solution, pour vivre le caractère plus ou moins masculin ou féminin dont ils ont hérité (il ne s’agit pas d’essentialisme), que de s’identifier à la catégorie, au genre, qui représente ce masculin ou ce féminin (dès lors qu’il est en mesure de percevoir la différence de normes de genre imposées aux filles et garçons).
II – Les autorités françaises traitent la transidentité en tant que maladie psychiatrique.
Quant à la société occidentale, elle met sur le compte d’un trouble psychiatrique (appelé aussi « dysphorie de genre »), la démarche d’une personne voulant se faire passer officiellement, et en permanence, pour quelqu’un du « sexe » (en réalité du « genre ») opposé, parce que cela correspond à son ressenti. L’homosexualité n’est plus qualifiée de maladie par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1990, mais le transsexualisme figure toujours en tant que maladie psychiatrique dans la nosographie internationale (« trouble grave de l’identité sexuelle »). Même si la sécurité sociale n’en appelle plus, officiellement, à la notion de maladie psychiatrique pour rembourser les frais médicaux induits par le parcours de transformation physique (passage de l’ALD 23 à l’ALD 31 depuis le décret n° 2010-125 du 8 février 2010), les référentiels sur lesquels s’appuient les médecins et juristes français restent inchangés.
Cette approche des transsexuel(le)s (au début, c’était la seule catégorie envisagée) en tant que malades, pour questionnable qu’elle soit, a permis d’organiser un accueil (à la qualité contestée) médical, financier et juridique, du moins pour les personnes désirant une transformation de leurs parties génitales (« changement de sexe »). Le dispositif de réponse à ces demandes s’est mis en place dans les années 1970 essentiellement autour du cas des hommes voulant se faire opérer pour devenir femmes. Démarche inadmissible, « impensable », aux yeux d’une culture occidentale qui place très haut l’image de l’homme viril. Mais la détresse de ces personnes, qui les amenait souvent au suicide, a conduit les pouvoirs publics à permettre à certains chirurgiens des hôpitaux publics de pratiquer sur elles une opération « mutilante » qui ne pouvait être admise qu’en tant que soin répondant à une maladie dûment certifiée par un psychiatre. Le cas des femmes voulant se transformer en homme a « bénéficié » du même raisonnement, mais a été moins médiatisé. (cf. Maxime Foerster « Histoire des transsexuels en France, )
Le but essentiel des personnes trans étant d’être reconnues dans le genre qui leur correspond, s’est posée depuis le début la question de la modification des pièces d’identité : en l’absence de loi pour le changement d’état civil des personnes trans, les juges se doivent d’appliquer le principe selon lequel nul ne peut disposer librement de son état civil (« indisponibilité de l’état des personnes »). Mais dès lors que la démarche du « patient » a été provoquée par une maladie qui le contraint psychiquement, sa demande de modification de la mention du sexe n’est pas considérée comme un acte de libre disposition de son état civil. Cet argument n’aurait cependant pas suffi si la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’avait, en 1992, contraint la France à accepter les demandes au nom du respect de la vie privée (afin que les pièces d’identité ne dévoilent pas la transition), tout en maintenant pour le demandeur les conditions drastiques indiquées par la Cour européenne, à savoir : le diagnostic le syndrome du transsexualisme, un traitement médico-chirurgical suivi dans un but thérapeutique, une perte du sexe anatomique d’origine, une apparence physique proche de l’autre sexe, enfin, un comportement social correspondant à cette nouvelle apparence. Un véritable « parcours du combattant » pouvant durer des années…
Devant la détresse des personnes qui, ayant entamé un parcours de transformation, se retrouvent pendant tout ce temps avec une identité légale ne correspondant plus à leur apparence, le ministère de la justice a adressé aux procureurs, en 2010, une circulaire (ref Circulaire de la DACS n° CIV/07/10 du 14 mai 2010) afin que ces personnes puissent obtenir un nouvel état civil sans obligation de réaliser les opérations les opérations de chirurgie génitales, dès lors que seraient démontrées « la réalité du transsexualisme et l’irréversibilité des effets des traitements hormonaux pratiqués ». Dans deux arrêts rendus le 7 juin 2012 (N° 757 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/757_7_23518.html et n° 758 http://courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/758_7_23519.html),
la Cour de cassation a confirmé cette position, en maintenant la nécessité de prouver la réalité du syndrome transsexuel et l’obligation d’accepter si besoin des expertises judiciaires pour prouver l’irréversibilité de la transformation. Ainsi, le lien entre le sexe et le genre est maintenu, même s’il l’est de manière plus lâche.
L’exigence d’irréversibilité des traitements hormonaux qui, entre autres, entrainent la stérilité des patients, conduit les associations trans à dénoncer une volonté de « stérilisation des trans ». Certes, on peut imaginer que la hantise des gouvernants, surtout dans le climat actuel, est de voir apparaitre à la une des journaux des « hommes enceints » et de devoir justifier devant leurs électeurs que c’est l’État lui-même qui a officialisé « hommes » ces « parturients » d’un genre nouveau.
Mais on peut déceler des raisons plus profondes. Le « changement de sexe » étant pour un individu un acte conséquent, et pour les pouvoirs publics la perturbation d’un ordre considéré comme « naturel », les autorités judiciaires et médicales veulent s’assurer que la personne n’a vraiment pas le choix, qu’elle se conforme à un protocole reconnu et que son degré de détresse ne permet d’envisager aucune autre issue que l’opération chirurgicale, (« réponse folle à une demande folle » selon le mot attribué à Madame Colette Chiland). Ainsi, la personne transsexuelle, en se plaçant sous le statut de malade, en pratiquant un acte « sacrificiel » sur son corps, et au minimum en renonçant au fonctionnement et à la fertilité de son sexe d’origine, prouve que sa démarche, pour impensable qu’elle soit, est « authentique », « irrépressible », qu’elle mérite le respect et justifie la prise en charge financière des soins. Elle démontre aussi à ses proches qu’elle n’est pas vraiment responsable de ce qui arrive et, si sa transformation conduit à un divorce, celle-ci ne peut être qualifiée de faute.
Ainsi, l’exigence d’irréversibilité, au risque d’une infertilité, ne correspondrait pas au simple souhait de stériliser les trans, ce serait avant tout une demande de preuve de l’authenticité de la demande de « changement de sexe », celle-ci, pour l’État, ne pouvant se concevoir sans le renoncement au sexe d’origine, renoncement effectué sous l’emprise d’une maladie psychiatrique grave. Cependant, les personnes trans qui, avant de prendre des traitements hormonaux qui auront comme effet secondaire de les rendre stériles, demandent au CECOS (Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains) de conserver leurs gamètes, se voient opposer un refus au motif que leur demande serait de pure convenance et que leur traitement hormonal ne serait pas rendu nécessaire par une maladie… (cf. interview dans « La vie » du 24 janvier 2014 d’un représentant du Défenseur des Droits). Contradiction flagrante ! Et l’on se demande alors pourquoi le CECOS accepte de conserver les gamètes des hommes qui effectuent une vasectomie à titre de contraception. N’est-ce pas un soin de convenance ?
III – Pour la militance trans, l’accueil de la transidentité doit se fonder sur la liberté d’être soi.
Que vont alors devenir les personnes qui demandent à être appelées « femmes » (ou « hommes », dans l’autre sens) alors qu’en refusant toute médicalisation elles montrent qu’elles veulent conserver leur sexe génital mâle ou femelle, éventuellement en état de fonctionnement ? Aux yeux des autorités judiciaires, sur la base de la jurisprudence du la cour de cassation, elles ne sauraient être considérées comme de « vraies » trans.
Dès lors, pour accueillir ces personnes, le droit devrait cesser de s’appuyer sur l’idée de maladie (comme il s’appuyait sur la « détresse » pour permettre l’IVG), pour se fonder sur la liberté d’être soi, ou sur la notion de « santé » telle que définie par l’OMS, ce qui n’a rien à voir avec la mise en œuvre d’une théorie du genre imposée par les instances sociales ou politiques.
Les autorités ne devraient plus parler de transsexualisme mais de « transidentité », concept qui va bien au-delà des individus désirant une opération de changement de sexe, pour inclure toutes les personnes souhaitant être déclarées hommes ou femmes, ou même ni l’un ni l’autre, et refusant qu’on se préoccupe de leur sexe anatomique.
L’idée est qu’il faut inclure au rang des droits humains le droit de choisir son genre social si cela correspond à son ressenti intime. Ce concept a pris force suite à l’élaboration, par des experts en droits humains réunis en 2006 en Indonésie, des “Principes de Jogjakarta”. Ces recommandations ont inspiré le 18 décembre 2008 une déclaration de l’assemblée générale des nations unies. Elles ont également inspiré le rapport de 2009 de Monsieur Thomas Hammarberg, haut-commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe puis d’autres textes comme la résolution 1728 du Conseil de l’Europe ou la recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres en 2010, allant dans le sens d’un droit à choisir son genre légal.
Le fer de lance est la prise en compte de l’identité de genre ressentie : « l’identité de genre fait référence à l’expérience intime et personnelle du genre profondément vécu par chacun, à la conscience personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres) et d’autres expressions du genre, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire ».
Malheureusement, outre que les textes du Conseil de l’Europe ne s’imposent pas aux États, cette avancée se heurte encore à de sérieux obstacles :
- le premier est que les autorités d’un pays, même en acceptant apparemment les principes nouveaux, peuvent encore une fois se retrancher derrière le respect des définitions : si une loi est votée en faveur des « personnes transgenres » et/ou de celles qui auront un « ressenti de genre » spécifique, le juge ou l’administration pourra toujours exiger de la personne qu’elle démontre qu’elle est « transgenre » ou prouve l’authenticité de son « ressenti ». La seule formulation possible pour un changement d’état civil libre et gratuit, qui n’ait à souffrir d’aucun contrôle, est que « toute personne a le droit de faire indiquer le genre qu’elle désire sur son état civil ».
- le deuxième obstacle est que le « genre » lui-même n’est pas défini dans les textes. Pour faciliter le « droit au genre », il faudrait que le genre ne soit pas entendu comme l’ensemble des signes construits par une civilisation pour indiquer la possession par un individu d’un sexe anatomique mâle ou femelle l’intégrant à l’une des deux catégories sociales homme ou femme. Faut-il attendre une définition adéquate du genre, de telle sorte que l’on puisse, comme une religion par exemple, y adhérer par conviction, par opinion ?
L’Argentine a décidé, par une loi promulguée en 2012, de ne pas attendre la réponse à cette question pour accorder le droit de choisir librement son genre à l’état civil, sans avoir à invoquer la détresse d’une maladie psychiatrique, ni devoir attenter, par des traitements médicaux, à son intégrité physique et reproductive. C’est dire qu’une volonté politique forte peut, par la loi, passer par-dessus les atermoiements conceptuels. En France, sous la contrainte de la jurisprudence psychiatrisante de la Cour de Cassation, la procédure de changement d’identité reste lourde et onéreuse. Un avocat est nécessaire et certains juges imposent abusivement des expertises judiciaires. Une loi est donc vivement attendue par les militants pour instituer une procédure « libre et gratuite ».
S’agira-t-il pour autant du progrès ultime pour l’accueil de la transidentité en tant que phénomène inhérent à l’espèce humaine ? Charger l’État de camoufler, à travers l’état civil, le parcours transidentitaire d’une personne, n’est-ce pas maintenir durablement l’apparence d’une société où « normalement » n’existent que des hommes mâles et des femmes femelles ? Devoir jouer les rôles et apparences stéréotypés d’homme ou de femme, n’est-ce pas maintenir le fossé entre les deux genres ?
Et si le vrai progrès était qu’il ne soit plus gênant du tout, pour la vie professionnelle comme pour la vie sociale, qu’une personne d’apparence féminine ait une identité civile d’homme ? Ou l’inverse ? Ca ne regarderait plus l’Etat. Et, pour commencer, si l’Etat abandonnait la mention du « sexe » sur les pièces d’identité ? N’apparaissant plus comme le garant de cette mention, il serait moins crispé devant les demandes de modification.
Au-delà d’une évolution politique à courte vue, c’est donc un travail sur les mentalités de nos concitoyens qui est nécessaire. L’obtention de l’IVG (Inversion Volontaire de Genre), financée par la collectivité, sans invocation de la maladie, ni même de la détresse, risque d’être plus longue que l’obtention de l’Interruption Volontaire de Grossesse…
Anne-Gaëlle Duvochel, 11 février 2014
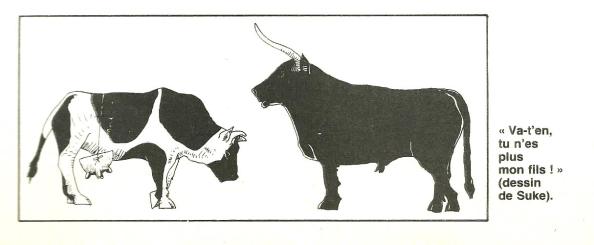


Derniers commentaires